Entretien
au coin du Net avec...
Jean-François PAYS
propos recueillis par Michel BONVALET
On
ne présente plus Jean-François PAYS aux lecteurs et
collectionneurs de Signe de Piste. Nous lui devons quelques titres
exceptionnels qui ont enrichi la collection pendant plus de 20 ans et
dont certains sont encore en vente chez Carnet2bord.
Vous trouverez sa bibliographie à la fin de cet interview. Nous avons d'ailleurs, sur ce site, mis en place deux fiches de lectures pour deux romans parus en 1976:
Hier la liberté et Le Dieu du Nil
Cet
auteur, dont la carrière professionnelle est passionnante, allant du
cinéma à la médecine, a eu la gentillesse de nous accorder cet
Entretien au coin du Net, nous permettant de mieux faire sa
connaissance.
Il a répondu sincérement et sans détours à nos questions indiscrêtes. Qu'il en soit ici remercié.
C'est avec un grand plaisir que nous vous livrons ci-dessous ces quelques confidences.
-
Cher Jean-François Pays, vous faites partie de ces auteurs Signe de Piste qui
nous ont donné envie de demeurer, au-delà du temps qui passe, de fidèles
lecteurs de la collection.
Votre
premier roman (Le Bal d’Hiver) date de 1958, vous aviez 22 ans. Pouvez-vous en
quelques phrases nous expliquer vos motivations envers l’écriture ? Votre
formation, je crois savoir, a été très diversifiée, vous destiniez-vous à la
littérature ?
- Non, pas du tout, plutôt au
cinéma. Mais, à cette époque, la chose
n’était pas facile. Sans production télévisuelle digne de ce nom, le marché
était relativement étroit et les places, dans une équipe de tournage, vraiment rares.
J’étais en Afrique en 1956. J’y
suis né. J’allais alors avoir 20 ans. Pour fêter cela, j’avais entrepris un long périple en voiture de plus
de 6000 kms qui m’avait amené d’Abidjan, plus exactement de Gagnoa, à
Tombouctou par Mopti et Hombori, avec un retour par la Guinée et les montagnes
du Fouta Djalon. Je m’en souviens comme si c’était hier. Il faisait une chaleur à crever et, en quelque
sorte pour me rafraichir, un soir, lors d’une étape, à la lumière d’une Pétromax
et face au désert, je me suis amusé à jeter
sur le papier les rudiments d’une conte fantastique qui se passait en hiver, à
l’époque des chevaliers teutoniques, dans une Allemagne de légende, avec
beaucoup de neige et un froid glacial qui changeait les humains en statues de
glace pour les punir d’abandonner leurs rêves pour un peu de bonheur. J’avais
presque oublié cette histoire avortée lorsque qu’à mon retour en France, après
une longue étape à Casablanca où vivaient mes meilleurs amis d’alors, j’ai
fait la connaissance d’Yves de Verdilhac.
J’avais lu sa Tache de vin. Nous avons donc naturellement parlé littérature de
jeunesse. Yves m’a vivement encouragé à
reprendre mon idée de conte fantastique en la transformant en roman dans l’esprit Signe de Piste. Et comme il
était alors directeur de la collection… C’est ainsi que le Bal d’Hiver a été écrit
en quelques semaines, en 1957, toujours en Afrique, lors d’un nouveau séjour. Pour
moi, c’est un livre raté, mais il occupe une place à part dans ce que j’ai bien
du mal à appeler mon œuvre. Je me suis aperçu en effet, il n’y a pas si longtemps
que cela, que le thème qui lui est sous-jacent se retrouve dans tous mes autres
livres, tantôt au premier plan et en pleine lumière, mais le plus souvent dans
l’ombre et en tache de fond, comme si ce thème me collait à la peau, ou plutôt, à la plume. Je ne sais plus trop quel auteur célèbre
disait de son œuvre à peu près ceci : « Finalement on écrit toujours
le même livre lorsqu’ on a eu la chance d’avoir trouvé quelque chose qui valait la peine d’être dit »
-
Votre carrière est très atypique et pour le moins intéressante : Vous avez
été assistant- réalisateur (pour François Truffaut avec lequel vous étiez ami,
entre autres), écrivain pour la jeunesse, à ce sujet vous êtes très orienté
vers l’histoire antique, et vous avez été professeur en médecine. Comment
expliquer ces différents parcours aussi passionnants les uns que les autres ?
Pouvez-vous
nous en dire plus sur votre orientation personnelle et professionnelle ?
- Je
ne peux pas dire grand-chose sur ma carrière car « faire carrière » présuppose des choix contraints pour atteindre
un but bien précis. J’ai toujours fait le contraire : ce que j’avais envie
de faire au moment où je l’ai fait. Je me rends compte aujourd’hui combien j’ai
eu de la chance qu’il ait pu en être ainsi.
Oui, j’ai
travaillé comme assistant avec différents réalisateurs, mais aussi et surtout comme
monteur. C’est là que j’ai appris l’essentiel de ce que je sais encore du
langage cinématographique. Un bon ou un mauvais montage peut sauver ou perdre
un film et un réalisateur qui n’assure pas le montage de son film n’en est pas,
pour moi, vraiment totalement l’auteur.

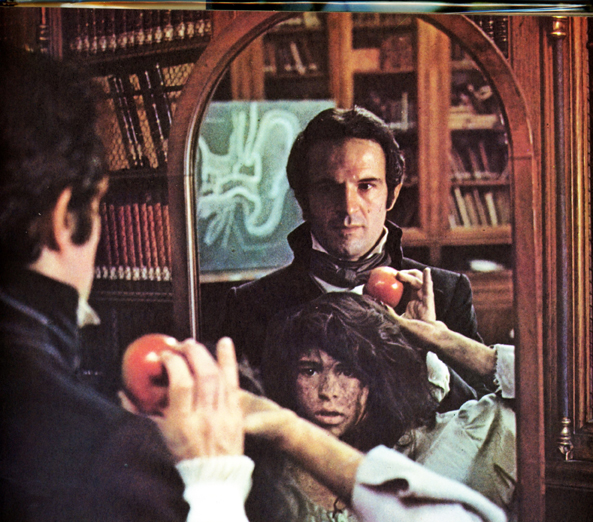
L'enfant sauvage de François Truffaut
Puis un jour j’ai eu « ma
claque », non pas du cinéma, mais du milieu cinéma que je n’avais du reste
jamais beaucoup apprécié. Je l’ai donc quitté sans trop de regrets pour faire à la Sorbonne, puis au Musée de
l’Homme, des études d’anthropologie et d’archéologie dans le cadre de ce que
l’on appelait alors une licence libre de lettres modernes. Lorsque je me suis
aperçu, diplômes en poche, qu’en persistant dans cette voie j’avais plus de
chances de passer la moitié de ma vie dans les caves d’un musée à classer et restaurer
des choses mortes qu’à monter, comme le héros du « Rendez-vous de
Juillet », des expéditions aux quatre coins de la planète - ce qui, à
l’époque, était mon rêve mais loin d’être aussi facile qu’aujourd’hui, car le
« sponsoring » n’existait pratiquement pas - j’ai commencé à regarder
ailleurs et je me suis inscrit pour partir en Arctique, comme membre des
expéditions polaires Paul Emile Victor C’est très exactement à ce moment-là que
le service militaire m’a rappelé à son bon souvenir. Redevenu civil 2 ans perdus plus
tard (c’était la fin de la guerre d’Algérie), j’ai alors décidé de «
faire médecine » car j’avais désormais envie de voir l’homme d’encore plus
près, en quelque sorte dans sa misère et de l’intérieur, et de me confronter à
des problèmes concrets dont le champ me paraissait soudain immense. J’avais alors
27 ans. Je ne me souvenais même plus de la formule de l’acide sulfurique, ce
qui était une véritable incongruité pour un candidat au PCB-PCEM qui avait la
juste réputation d’être un concours féroce. Aussi n’ai-je été admis qu’à la
session d’octobre. Mais après, tout s’est passé comme sur des roulettes et je
me suis retrouvé très vite de l’autre côté de la barrière puis, passées quelques années d’assistanat et d’études
supplémentaires, finalement professeur de Parasitologie Médicale à la tête du
laboratoire de Pathologie Exotique de la
Faculté de Médecine Necker Enfants Malades, et d’une consultation spécialisée
en Médecine Tropicale à l’hôpital de l’Institut Pasteur.
-
Avez-vous pratiqué le scoutisme ?
- Non, jamais.
-
Comment avez-vous été amené à réaliser le film « Hier la
Liberté » ? Comment s’est articulée votre collaboration avec
Jean-Louis Foncine en tant que scénariste, acteur puis co-auteur du roman tiré
du film ?
- J’avais
fait depuis longtemps la connaissance de Jean-Louis Foncine, alias Pierre
Lamoureux, et j’ai eu un jour l’idée, pour renouer un peu avec le cinéma et
surtout me servir de la meilleure caméra amateur du moment que je venais de
m’offrir, de tourner un long métrage super 8, ce qui ne s’était que très
rarement fait en raison des difficultés techniques que cela représentait. Pour
ne pas multiplier les difficultés (je m’en suis expliqué auprès de Christian Floquet au sujet
du DVD « Les cent camarades » de G. Ferney), j’ai choisi une histoire
qui pouvait être tournée à la campagne, en un lieu unique (un village et ses
environs) et qui fasse essentiellement appel à des acteurs amateurs enfants ou
adolescents, beaucoup plus faciles à mobiliser pendant trois semaines de
vacances que des adultes. Quant au scénario, j’inventais une histoire à mi-chemin
entre la Guerre des boutons et la Bande des Ayacks en évitant, comme le
faisaient ces deux ouvrages, de trop caricaturer les adultes ou, pire, de les
ridiculiser comme c’était systématiquement le cas dans tous les films pour la jeunesse de l’époque. J’introduisais
également dans l’histoire un thème qui m’est cher- celui du Sorcier aux yeux bleus,
- c’est à dire l’intolérance sous toutes ses formes, et non uniquement sous celles
reconnues et fustigées aujourd’hui par la doxa. C’est la raison pour laquelle
j’ai choisi un acteur brun et l’autre
blond et les ai associés comme victimes. Par contre, pour répondre par avance à
une question qui m’est fréquemment posée, le fait d’avoir fait du blond un
Norvégien n’a rien à voir avec la série des Eric. J’ai parlé de mon projet à J.-L.
Foncine qui s’est dit aussitôt partant, mettant à ma disposition la moitié de Malaïac
(Malans), sa propre personne, sa ou
plutôt ses maisons, et toutes les ressources du Pays perdu. Tirer
ensuite ensemble un livre de cette aventure allait de soi.
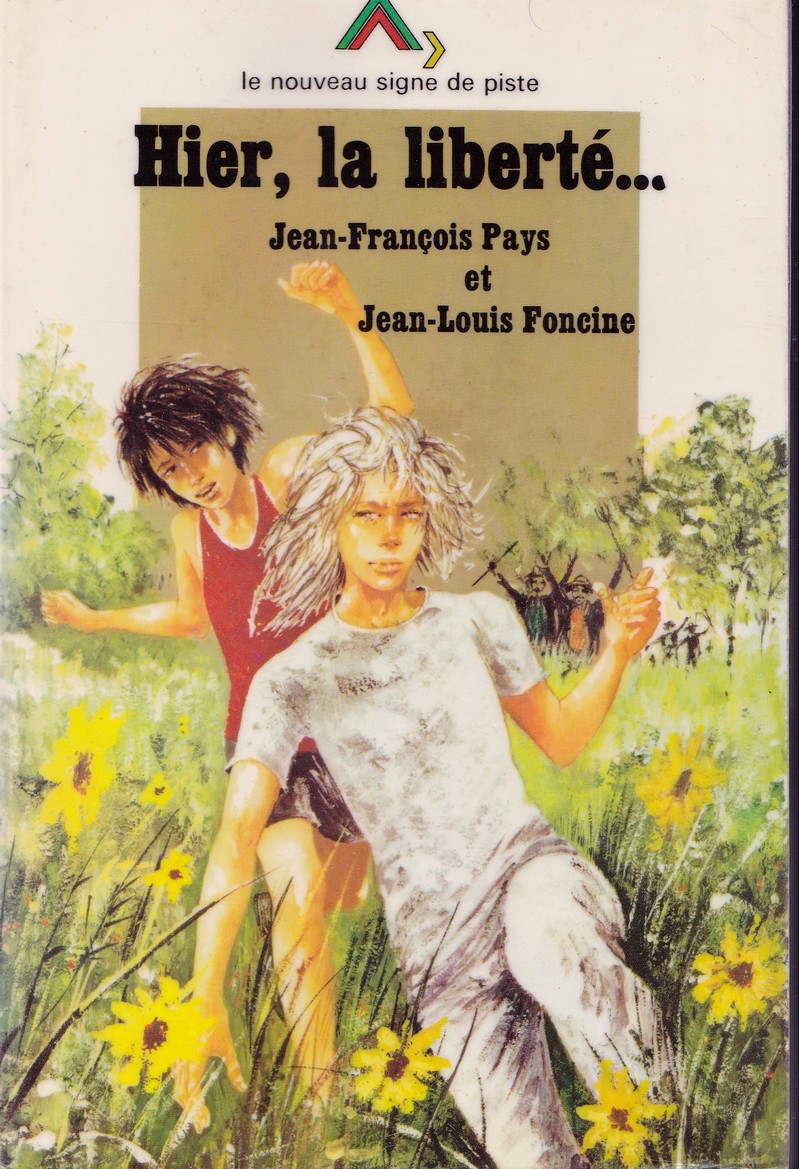
-
Vous avez fait tourner des acteurs professionnels, des personnalités du Signe
de Piste dont Michel Gourlier et des ados, quels sont vos souvenirs marquants
de ce tournage ? Avez-vous revu certains de vos acteurs ? Que
sont-ils devenus ?
- Des
trois principaux acteurs du film, j’en ai perdu deux de vue : un, très
vite, le second après quelques années, mais le troisième est toujours un de mes
meilleurs amis. Nous ne nous voyons pas très souvent car il travaille au
quatre coins du monde. Mais c’est toujours avec un grand plaisir que nous nous
retrouvons et nous faisons même parfois quelques voyages ensemble. Le temps a
passé sur les autres et, hélas, sur certains, la mort aussi. Quant à vous
raconter le tournage du film, quarante ans plus tard, je n’en ai guère envie.
Compte tenu des problèmes de tous ordres qu’il fallait sans cesse régler, je
dirai simplement que cela a été pour moi trois bonnes semaines de cauchemar
entrecoupées de courtes périodes de pur plaisir.
-Pensez-vous
éditer ou faire éditer un DVD de ce film ?
- Je
ne sais pas. On me l’a souvent demandé. Il existe un problème de taille concernant
la musique de ce film. Il me faudrait le
régler au préalable si je me décidais à l’éditer, et ce n’est vraiment pas
simple du tout. Ensuite, la certitude de voir ce DVD piraté dès sa sortie
publique ne m’encourage guère à le faire. De plus, à part quelques inconditionnels
du Signe de Piste, je crains qu’ Hier, la liberté… n’intéresse plus grand
monde. Enfin, à l’époque des caméscopes HD à trois euros six sous et des logiciels
de montage automatique, je crains également que personne ne comprenne et
n’imagine les difficultés qu’il y avait à faire un long métrage S8 dans les
années 70, et ne lui pardonne ses imperfections techniques.
-
Vous avez écrit 9 romans Signe de Piste, dont certains ont pour cadre
l’Antiquité, Rome et surtout l’Egypte des Pharaons (l’un d’entre eux a atteint
les 100.000 exemplaires) D’où vous vient cette passion pour l’histoire des
peuples, car vos écrits sont de véritables traités d’histoire vulgarisée et à
la portée de tous ?
- En
réalité, je n’ai écrit que deux romans Signe de Piste : le Bal d’hiver et
le Rendez-vous de Casablanca. Tous mes autres livres sont d’abord parus chez
d’autres éditeurs et dans d’autres collections (Rouge et Or, Presses de la Cité…)
et c’est seulement dans un deuxième temps qu’ils ont été repris par la
collection Signe de piste.
D’où
vient mon goût pour l’histoire ? Je ne sais vraiment pas. Peut-être en
partie parce que je n’ai jamais beaucoup aimé, et aime de moins en moins,
vivre dans le monde qu’on est en train de me fabriquer. C’est du reste un peu
ce que disait un de mes professeurs, Claude Lévy- Strauss, l’auteur de Tristes
Tropiques, à la fin du long interview qu’il accorda, presque centenaire, à un
journaliste de télévision.
-
Vous avez abordé des thèmes divers (L’enfant
Sauvage, La Montagne interdite, Le Rendez-vous de Casablanca…) toujours sous
l’aspect humaniste, comment choisissez-vous les sujets de vos romans ? Sont-ils liés à des souvenirs ou des lieux
personnels ?
- Je vous ai dit quelques mots de
la genèse du Bal d’Hiver. Le Rendez-vous de Casablanca est une histoire qui
contient beaucoup de faits réels et certains des personnages sont même les
enfants de la famille par laquelle je m’étais fait alors en quelque sorte
adopté. Je connais bien le massif de la Meije et les différentes voies
d’escalade, et évidemment cela a joué un rôle important dans l’écriture de la
Montagne Interdite. J’avais également rencontré l’alpiniste Maurice Herzog au
club des Jeunes Explorateurs, à Paris, une dizaine d’années après sa fameuse
ascension de l’Annapurna. Nous avions eu l’occasion d’y échanger quelques idées
sur le fait que la cordée n’avait pas utilisé de masque à oxygène pour lancer l’assaut
final. Cette rencontre et tout ce qui se disait déjà sous le manteau concernant
la façon dont cette expédition s’était vraiment déroulée, n’ont pas été étrangers
à l’écriture de certains passages de la Montagne Interdite.
Je connais bien également la
Norvège et j’ai passé au moins cinq fois
le cercle polaire, une fois même, pour les besoins du film, avec un des acteurs
d’Hier la liberté. Lorsque j’ai écrit le Sorcier aux yeux bleus, ce que l’un
de mes autres professeurs en Sorbonne, André Leroy Gourhan, appelait la culture
du Renne m’était très familière puisqu’ elle avait été le sujet d’un mémoire
que j’avais rédigé dans le cadre de mon certificat de licence d’Archéologie
préhistorique. Je me suis évidemment largement servi des connaissances acquises
lors de la rédaction de ce mémoire pour écrire le roman.
Quant à la période romaine des empereurs par
adoption, c’est ma période de prédilection, celle pendant laquelle j’aurais aimé
vivre…dans la peau d’un patricien bien entendu ! Toukaram est mon livre
fétiche. Il doit beaucoup à Marguerite Yourcenar. Les Mémoires d’Hadrien est en effet, depuis sa parution, un
de mes livres de chevet, avec quelques autres, comme les Pensées pour moi-même
de Marc Aurèle et les Sept Piliers de la Sagesse de TE Lawrence. Cela ne veut
pas dire que je suis un véritable
stoïcien. J’aime tout au contraire mêler les doctrines de Zénon et
d’Epictète à celle d’ Epicure.
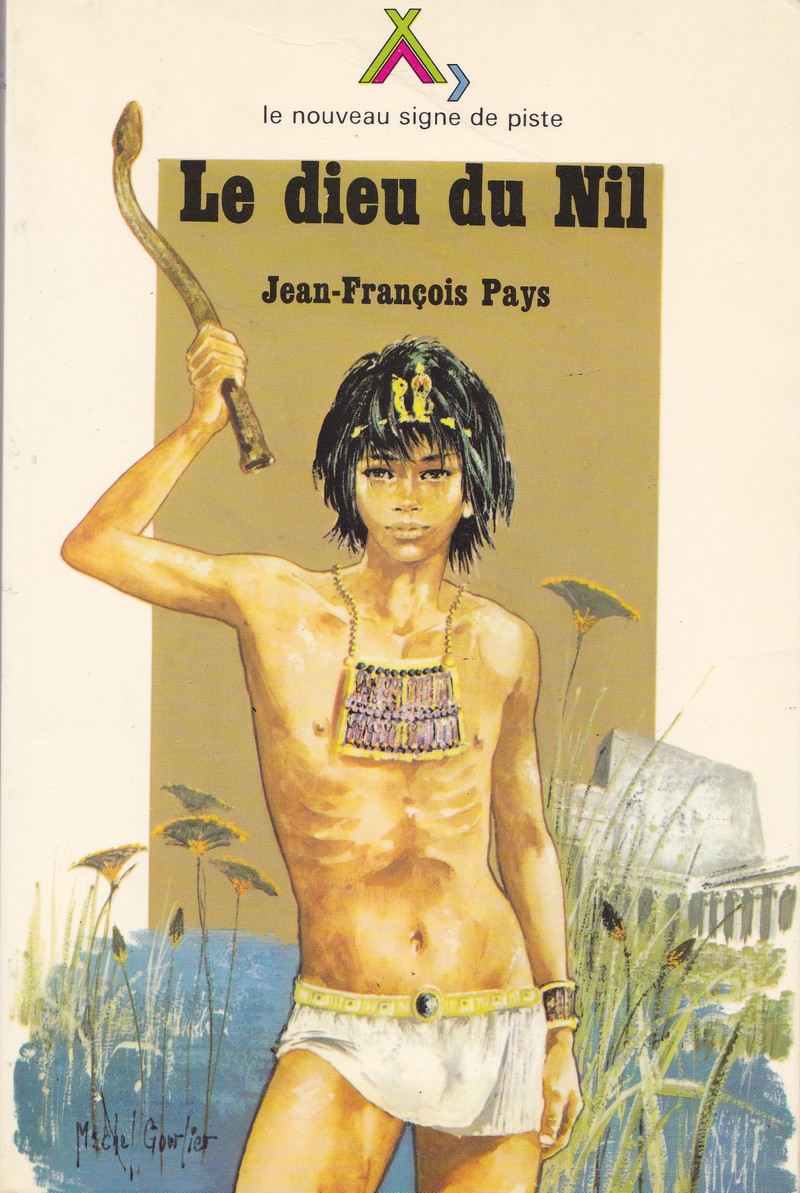
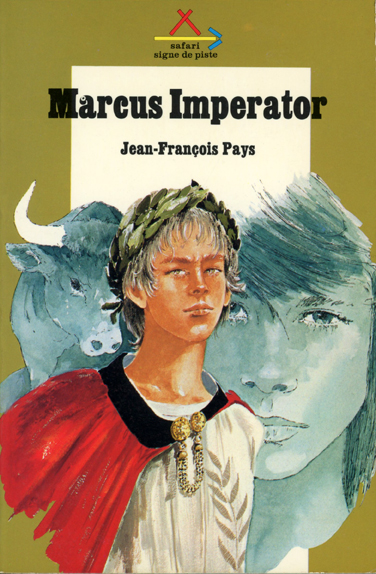
Toutankhamon est une œuvre de
commande de la collection Rouge et Or à l’occasion de l’exposition des trésors
de Toutankhamon au Grand Palais organisée par Desroches-Noblecourt et inaugurée
par Malraux en 1967. Son écriture m’a obligé
à approfondir ce que je savais déjà de cette extraordinaire civilisation pour
laquelle je n’avais toutefois pas la même attirance que pour celles de la Grèce
et de Rome. Les derniers examens (2010) pratiqués sur la momie du jeune pharaon
et sur sa parentèle ont soulevé plus de
problèmes qu’ils n’en ont résolus, notamment au plan médical. Cela m’a conduit
à écrire un article scientifique contestant en partie les conclusions du Directeur des antiquités égyptiennes d’alors sur
l’état de santé du pharaon et les raisons de sa mort, et à envisager une
réécriture de mon roman. Pour ceux que ça intéresse, l’article en question peut
être consulté sur internet sous le titre de Plasmodium
falciparum toutankhamonensis.
-« Le
sorcier aux yeux bleus » est un roman qui traite de l’exclusion voire du
racisme, a-t-il tenu une place particulière dans votre œuvre littéraire ?
- Racisme
et exclusion sont des thèmes que l’on retrouve également sous une autre forme dans
Hier, la liberté…J’ai écrit le Sorcier à une époque où on ne parlait guère encore de ces sujets qui devaient
devenir pourtant, quelques années plus tard, des banalités politiquement
manipulées par tous au point de vider rapidement les mots de leur sens. Très
peu de critiques, à la sortie du livre, ont signalé mon engagement dans ce
combat, probablement parce que l’exclusion et le racisme que je mettais en
scène n’allait pas dans le « bon sens », et que mon livre, en
revenant aux fondamentaux, inversait les données de la doxa qui était en train
de se constituer. Il ne faut jamais oublier en effet qu’en matière de
persécutions et d’intolérance, les victimes d’aujourd’hui sont souvent les
bourreaux de demain. Tant pis ! Il
y a même eu une sérieuse proposition des soviétiques (Soviet-Export Films) séduits
peut-être par la dernière phrase du bouquin (qui parlait d’un espoir qui, avec
le soleil, se lèverait bientôt à l’est !), pour faire une adaptation cinématographique du
Sorcier aux yeux bleus qui devait être tournée en Sibérie, mais le projet a
finalement échoué. Je l’ai beaucoup
regretté car cela m’aurait beaucoup amusé.
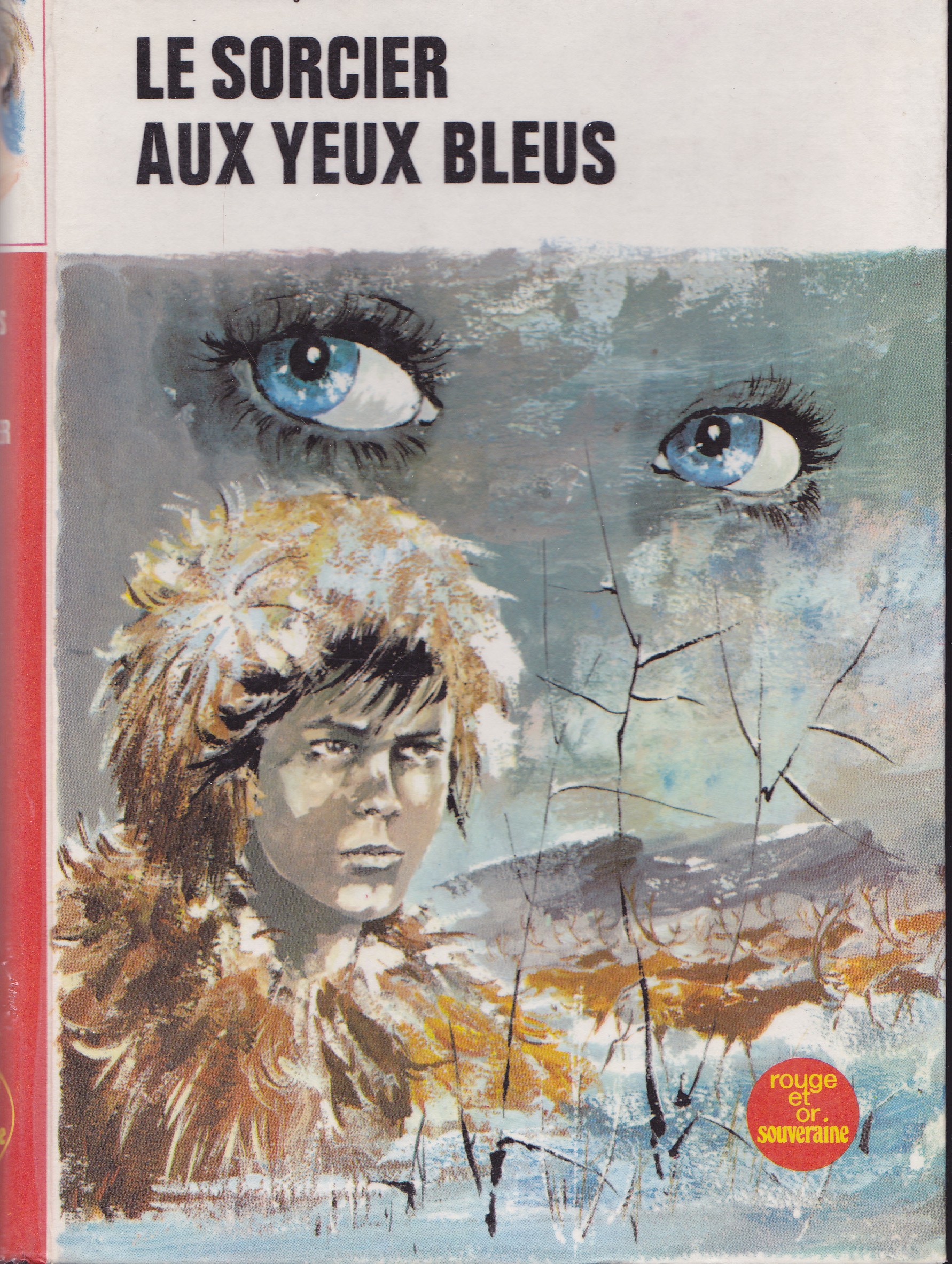
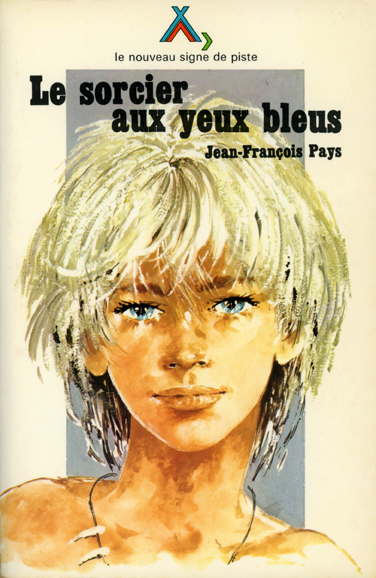
-
Vos romans sont toujours remarquablement documentés, entraînant le lecteur dans
la vie quotidienne des héros. Avez-vous une méthode de travail
particulière ?
- Non.
Pas vraiment. Je ne suis pas un homme de bibliothèque. Je lis au préalable ce
qui me paraît essentiel sur le sujet. Je laisse ensuite aller mon imagination
et je contrôle a posteriori. La plupart du temps, comme dirait un de mes amis de
Neufchâtel, «c’est tout bon ». Si cela ne l’est pas, je rectifie, mais je
n’écris jamais en me référant sans cesse à une pile de documents. Toukaram, et les deux autres
volumes du Signe de Rome, ont servi pendant longtemps dans plusieurs collèges pour initier les élèves au monde
romain. J’en ai été très heureux. J’aurais aimé qu’il en soit également ainsi
pour la civilisation égyptienne avec la nouvelle version du Dieu du Nil que
j’ai terminée il n’y a pas très longtemps, mais l’éditeur qui détient les
droits de la première version en a décidé autrement et cette nouvelle version ne verra probablement jamais le jour. Elle
est pourtant nettement différente de la première, meilleure et mieux écrite
selon ceux qui l’ont lue et surtout beaucoup plus précise et riche au plan
historique puisqu’elle intègre tout ce que l’on a appris depuis 40 ans sur la
vie et la mort du jeune pharaon.
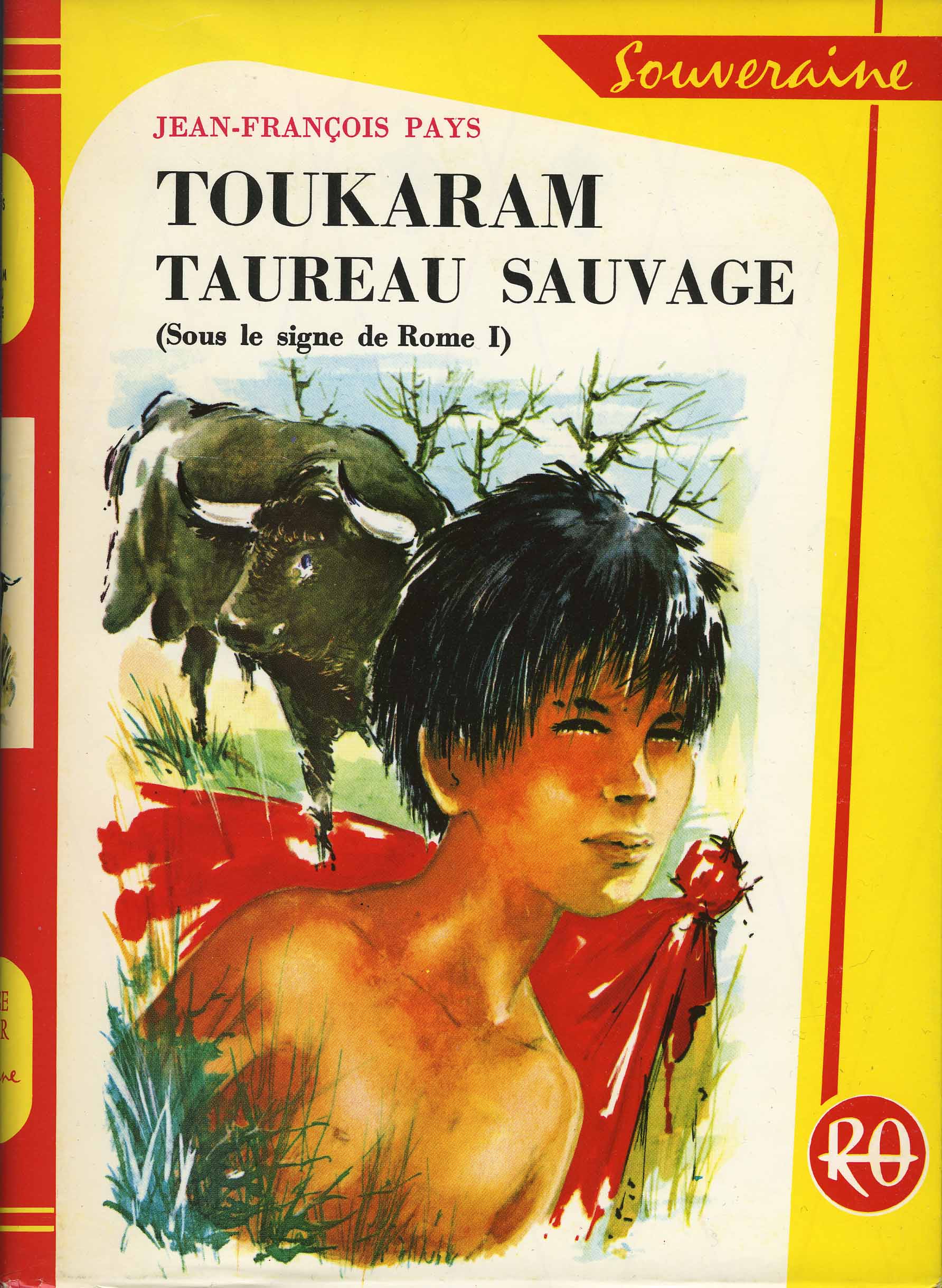
Un de mes premiers soucis, lorsque j’écris un roman
historique, est de ne pas porter de jugement de valeur sur la société que j’ai
choisi de faire revivre et de pas faire cet énorme contre-sens historique,
devenu pourtant monnaie courante aujourd’hui, qui consiste à juger les sociétés
du passé à l’aune de la morale du
présent. Beaucoup de gens prennent connaissance de l’histoire au travers des
œuvres de fiction. C’est une des raisons pour lesquelles je considère qu’un
roman historique ne peut, sous le prétexte d’être un roman, prendre de libertés
avec l’histoire, ou la distordre, sans
le signaler très clairement au lecteur. L’imagination, dans ce type d’ouvrage,
ne doit y avoir de place que dans les interstices et les lacunes de notre
connaissance du passé. Elle peut avoir, par contre, toute sa place dès qu’il
s’agit de personnages inventés dans la mesure où ils n’interfèrent pas
directement avec des faits connus et sont d’emblée présentés comme tels. C’est
d’un savant mélange entre ces exigences et ces libertés que naissent les plus
belles réussites en la matière.
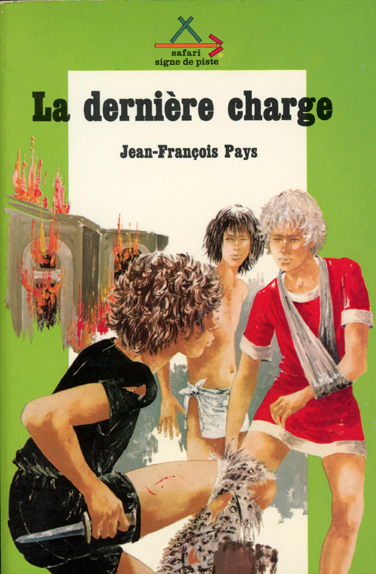
-
Avez-vous d’autres projets d’écriture en cours ?
- J’en ai eu trois que j’ai
fini par abandonner l’un après l’autre pour des raisons différentes. Le premier
concernait les Guaranis, un peuple amérindien du Paraguay et du nord-est de
l’Argentine, pays que j’ai maintes fois parcouru. Le second portait sur le
Chemin des Larmes, ces quelques 1700 kms de route que durent parcourir vers
l’exil les Cherokees spoliés de leur terre par les colons européens et sur laquelle
4 à 8000 indiens sur les 17 000 que comptait la tribu trouvèrent la mort.
Le troisième avait pour ambition de faire revivre la civilisation khmère au
temps de la construction de la fabuleuse cité d’Angkor Tom. J’ai en effet passé
pas mal de temps au Cambodge où je me suis rendu une bonne douzaine de fois, le
plus souvent dans le cadre d’une petite ONG médicale que j’y avais créée avant
la fin de la guerre civile. Je crois assez bien connaître l’histoire de ce pays.
En fait, tous ces romans avortés, avec ceux qui ne l’ont pas été, faisaient
partie d’un projet très ambitieux qui aurait dû se terminer par un dernier
livre établissant une sorte de filiation dans le temps et dans
l’espace entre mes différents héros. J’ajoute, pour être tout à fait complet
sur ce sujet, avoir même un temps caressé le projet d’écrire à ma manière une
version pour la jeunesse de l’Anneau des Niebelungen en essayant de mettre en
relief l’extraordinaire puissance, l’universalité et la modernité du mythe que
nous conte cette saga. Siegfried, dans la légende, n’a que 15 ans, et on peut
imaginer que Brunnehilde n’en a guère plus. Tous deux, pour moi, sont moins des héros guerriers et conquérants
que des victimes sacrificielles offertes aux Normes du Temps pour que naisse un
autre monde censé être meilleur que le précédent. Si l’on donnait leur âge
véritable aux protagonistes de ce drame- mais cela est impossible - on
résoudrait en grande partie le problème des opéras de Wagner qui est celui de
passer sans arrêt du sublime, par leur musique, au grotesque, quand ce n’est au
sordide, par leurs mises en scène ainsi que par l’âge et la corpulence des
chanteurs. Mais je me laisse aller sur un sujet hors sujet… puisque mes
responsabilités professionnelles ne m’ont pas laissé le loisir de me lancer
dans l’aventure des Niebelungen, et que j’ai arrêté d’écrire des romans pour la
jeunesse en 1972, consacrant dès lors mon activité « littéraire » et
même cinématographique à la réalisation de films et à la rédaction d’articles et de livres médico-scientifiques.
La retraite aujourd’hui me laisse
un peu plus de temps. Après la réécriture du Dieu du Nil, je souhaiterais la mettre à profit pour réécrire
le Bal d’hiver et faire quelques retouches sur Toukaram pour lequel, à
l’origine, il n’avait pas été prévu de suite,
afin de mieux adapter l’intrigue du premier volume à celles des volumes
suivants. Mais, compte tenu des risques de ne pas trouver d’éditeur ou de
retomber dans la mésaventure de la réécriture du Dieu du Nil, j’hésite à me
mettre au travail. Peut-être ne devrai-je pas, mais j’ai toujours été, en matière de littérature de
jeunesse, un auteur gâté puisque je n’ai écrit mes bouquins, sauf le Bal
d’Hiver, que contrat signé en poche. On ne peut demander à un bébé élevé au
caviar de raffoler des rutabagas !
-
For de votre expérience d’auteur, quel conseil donneriez-vous à un auteur
souhaitant écrire des romans s’adressant à la jeunesse actuelle ?-
- Comme je viens de le dire, je n’écris
plus de roman pour la jeunesse depuis longtemps et n’ai aucun contact, de par
mon métier, avec le monde des pré-adolescents avec lequel je pense du reste
avoir cessé d’être en phase. Je ne partage pas en effet leur goût pour les
manches à balai volants, les baguettes magiques, la sorcellerie, le merveilleux de pacotille et
les « heroic fantasies » à l’américaine ou à la japonaise dont ils
semblent si friands. Je crains donc d’être incapable d’écrire pour eux, dans le
contexte présent, une histoire capable
de leur plaire et de les détourner de leurs robots. Comment pourrais-je donc dans
ce cas avoir la prétention de donner des conseils à un jeune auteur ? Tout
au plus pourrais-je lui dire que, pour moi, un bon livre pour la jeunesse, contrairement
à ce que l’on pense habituellement, est un livre sans parti pris moralisateur
et idéologique, où le non écrit doit
avoir autant d’importance que l’écrit. Tout en restant simple, un tel
livre surtout ne doit jamais être simpliste,
ce qui implique qu’il soit écrit de manière à offrir plusieurs degrés de lecture
et aborde des thèmes ayant une résonnance universelle, à la fois ancrés dans le
temps et hors du temps, pour raconter une histoire capable de laisser dans la bouche de celui qui en tourne
la dernière page, comme certains vins savent si bien le faire après la dernière
gorgée, un arrière-goût ineffable dont le
jeune lecteur se souviendra bien après que n’ait sonné pour lui l’heure des
responsabilités, des déceptions, des choix, donc des renoncements de l’âge
adulte. Etre adulte en effet, c’est non seulement perdre sa capacité
d’indignation, mais surtout ne plus accepter d’écouter pleurer sur ses rêves l’enfant
qui n’en finit pas d’agoniser en chacun de nous.
Ambition démesurée, prétention ridicule et
mission impossible me direz-vous ? Certainement.
Raison de plus, cher collègue, pour s’y essayer dès aujourd’ hui.
Bibliographie de Jean-François PAYS :
Le Bal d'Hiver 1958
Le Rendez-vous de Casablanca 1961
Le Sorcier aux yeux bleus 1972/1978
La Montagne Interdite 1972/1979
Toukaram, taureau sauvage 1973
La dernière charge 1973
Marcus Imperator 1974
Hier, la Liberté 1976
Le Dieu du Nil 1976





